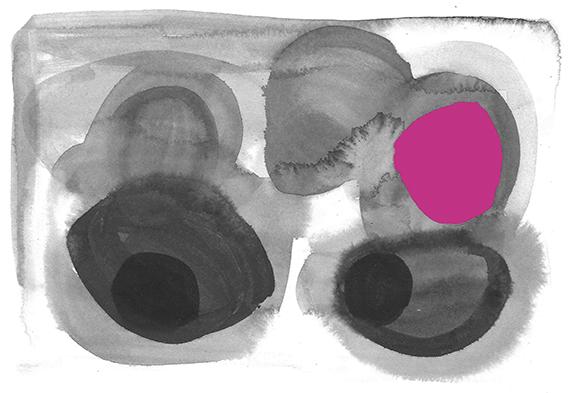Sosf : Dans le cadre de la réforme du RAEC, la banque de données Eurodac sera développée pour devenir un système d’information complet sur l’asile. Quels seront ses objectifs à l’avenir ?
Hanna Stoll : Actuellement, Eurodac enregistre dix empreintes digitales et le sexe des personnes qui déposent une demande d’asile ou qui ont été appréhendées lors du franchissement non documenté des frontières extérieures de l’UE. Il est ainsi possible de déterminer si elles ont déjà été enregistrées dans un autre pays et si ce dernier est éventuellement responsable de la mise en œuvre d’une procédure d’asile. Cette finalité étroitement définie est fortement élargie dans le nouveau règlement Eurodac.
Désormais, Eurodac sert aussi explicitement au contrôle et à la lutte contre la migration irrégulière, notamment la migration dite secondaire, à l’identification en vue du rapatriement et aux poursuites pénales. Cette extension des finalités légales crée de nouvelles possibilités d’utilisation qui n’étaient pas autorisées jusqu’à présent.
Quelles sont les nouvelles données saisies à cet effet ?
Outre les empreintes digitales et le sexe, Eurodac enregistre des images biométriques du visage et, pour la première fois, des données personnelles : les prénoms et noms de famille, les noms alias, les noms de naissance, la date et le lieu de naissance, les nationalités, le type, le numéro et la date d’expiration des documents d’identité et de voyage, des informations sur leur authenticité ainsi que des copies couleur scannées de ces documents. Sont également enregistrés l’État membre saisissant et l’État membre responsable selon Dublin, les éventuels transferts, départs ou expulsions et si une demande d’asile a été définitivement rejetée ou considérée comme irrecevable ou infondée. En outre, un examen sommaire est effectué en amont pour déterminer si une personne pourrait représenter un risque pour la sécurité. Si c’est le cas, il faut déterminer si la personne est violente ou armée, ou s’il y a des raisons de penser qu’elle est impliquée dans un délit. Si c’est le cas, cela est également consigné dans Eurodac.
Tout cela dès l’âge de six ans et non seulement pour les personnes qui déposent une demande d’asile, mais aussi pour les personnes sans-papiers appréhendées sur le territoire national, des personnes bénéficiant d’une protection temporaire, des réfugié·es réinstallé·es et des personnes sauvées en mer.
Que fait-on de toutes ces données ?
L’argument souvent avancé est que les personnes en fuite sont ainsi plus facilement identifiables et que les renvois sont simplifiés. Mais j’ose douter qu’une grande partie des expulsions échouent aujourd’hui réellement en raison d’un manque d’identification.
Il est clair que l’UE et les États membres veulent ainsi générer des connaissances approfondies sur les mouvements de fuite et de migration au sein de l’Europe. Eu-LISA, l’agence de l’UE qui gère Eurodac, procédera par exemple à l’avenir à des évaluations statistiques mensuelles des données Eurodac sur la base de plus de 80 critères, qui serviront bien entendu à renforcer le contrôle et la surveillance.
À l’avenir, Eurodac ne sera plus un système isolé, mais sera relié à d’autres banques de données de l’UE dans le cadre de ce que l’on appelle l’interopérabilité. Les données seront donc utilisées au-delà d’Eurodac et non plus seulement à des fins de politique migratoire ou d’asile, mais aussi à des fins de police et de sécurité.
Quels problèmes en découlent ?
Les frontières entre le droit administratif et le droit pénal sont de plus en plus floues. Par exemple, si le contrôle de sécurité donne un résultat positif dans la banque de données, indiquant une menace pour la sécurité intérieure, et qu’une personne est classée comme « violente » ou « armée », cela peut être enregistré dans Eurodac et entraîner la suspension de la procédure d’asile dans un premier temps. En fait, un tel cas devrait simplement faire l’objet d’une plainte. Mais si, en raison de cette inscription, la personne est privée de droits procéduraux importants et potentiellement de droits matériels tels que l’accès à l’asile, cela est problématique d’un point de vue juridique.
En Suisse, Fedpol, le service de renseignement de la Confédération ainsi que les polices cantonales et municipales ont désormais accès à Eurodac pour enquêter et prévenir les délits. Cela repose sur une inégalité de traitement des demandeur·ses d’asile. En effet, ces autorités n’ont pas accès aux données biométriques des personnes sans antécédents judiciaires – du moins jusqu’à présent, pas à l’échelle européenne. La seule raison pour laquelle elles y ont accès est l’origine des personnes enregistrées, ce qui est discriminatoire. De plus, cette discrimination sera renforcée par le fait que les demandeur·ses d’asile pourront se voir attribuer davantage de délits grâce à une base de données plus complète. On aura donc l’impression qu’elles sont effectivement plus souvent délinquantes. Or, c’est seulement le taux d’élucidation qui est plus élevé.
Quelles seront les conséquences pour les personnes en fuite ?
Lorsque des données aussi sensibles que les empreintes digitales et les images faciales sont saisies et rendues accessibles à grande échelle, il faut accorder une importance particulière à la proportionnalité. Or, avec Eurodac, celle-ci n’est même plus remise en question.
Si ces données sont en outre introduites dans un réseau de données complexe et interopérable, les normes de protection des données devraient être d’autant plus élevées. Les « sujets de données » devraient être informés et pouvoir comprendre ce qu’il advient de leurs données, pourquoi elles sont collectées et à quelles fins elles sont utilisées. Si ce n’est pas le cas, ils ne peuvent pas non plus faire valoir leurs droits, par exemple en matière de consultation et de correction. Les erreurs lors de la collecte des données sont étonnamment fréquentes et se multiplient justement dans les systèmes interopérables – avec des conséquences imprévisibles.
Tu as récemment participé à la procédure de consultation sur la réforme d’Eurodac. Qu’est-ce que tu reproches concrètement à la mise en œuvre prévue en Suisse ?
Il y a différents aspects qui devraient être améliorés ou précisés dans la mise en œuvre. À titre d’exemple : aujourd’hui déjà, selon différentes études, Eurodac est à peine comprise par les demandeur·ses d’asile. Jusqu’à présent, la Suisse a traité le droit à l’information avec négligence et la mise en œuvre proposée par le Conseil fédéral ne prévoit pas de renforcer ce droit.
Que proposes-tu à la place ?
Premièrement, il devrait y avoir une représentation juridique gratuite dès la collecte des données dans le cadre du screening, qui serait également compétente en cas de rectification des données ou des résultats et conséquences du contrôle de sécurité.
Deuxièmement, l’accès des services répressifs devrait être soumis à un contrôle judiciaire et ne pas être seulement autorisé par la police fédérale.
Troisièmement, les personnes concernées devraient être informées lorsqu’une recherche effectuée par la police donne un résultat positif dans la banque de données. Et si des données sont transmises à des pays tiers à des fins de rapatriement, cela devrait toujours être justifié et il faudrait une prise de position sur le niveau de protection des données du pays tiers. Il doit également exister des procédures permettant aux personnes d’accéder à leurs données après avoir dû quitter l’espace Schengen. Les données Eurodac sont parfois conservées et réutilisées pendant des années.
Or, rien de tout cela n’est prévu actuellement. N’oublions pas qu’il s’agit également des empreintes digitales et des images faciales d’enfants à partir de six ans. Il devrait de toute façon être exclu que celles-ci soient enregistrées et utilisées par les forces de police.
Hanna Stoll, Juriste à l’Université de Zurich et membre du comité de Solidarité sans frontières.
Cet article a d'abord été publié dans le Bulletin Sosf n° 4/2024.